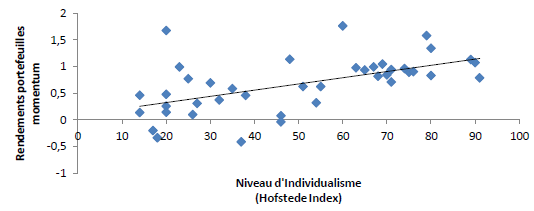"En période de mobilité économique, la souplesse est une condition vitale du plein emploi" - Alfred SAUVY
"Dans ce monde complexe où l’information n’a jamais été aussi abondante, nous devons développer l’intelligence économique " - Jean ARTHUIS
"La première panacée pour une nation mal dirigée est l’inflation monétaire, la seconde est la guerre. Les deux apportent prospérité temporaire et destruction indélébile. Les deux sont le refuge des opportunistes économiques et politiques" - Ernest HEMINGWAY
"Les crises de demain sont souvent le refus des questions d’aujourd’hui " - Patrick LAGADEC
"Les bonnes questions ne se satisfont pas de réponses faciles" - Paul SAMUELSON
"Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe" - Alexis De TOCQUEVILLE
"Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées." - Winston CHURCHILL
"On attire l'ennemi par la perspective d'un avantage ; on l'écarte par la crainte d'un dommage. " - SUN TZU
"On n’est jamais mieux gouverné que lorsqu’il n’y a pas de gouvernement" - Jean-Baptiste SAY
"La guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens" - Carl VON CLAUSEWITZ